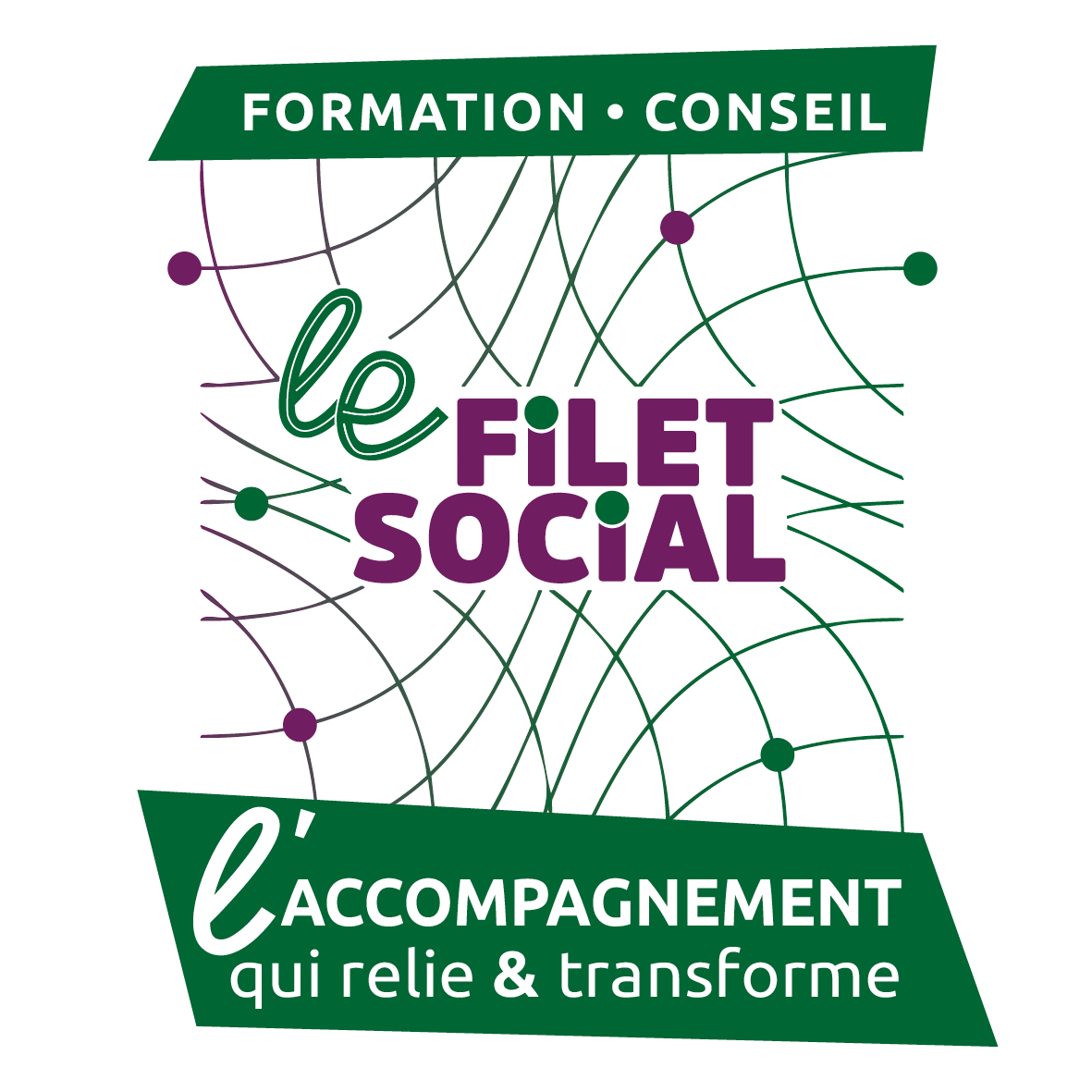Les compétences relationnelles sont l’une des composantes essentielles que doit acquérir le travailleur social. Si certains aspects sont enseignés en formation initiale, une bonne part vient des expériences de terrain après avoir pu mesurer l’impact des interactions quotidiennes avec le public accompagné. Dans mon expérience avec des jeunes âgés de 18 à 25 ans ayant des parcours de rue, j’ai beaucoup appris sur le relationnel lorsque leurs vies sont marquées de ruptures voir de traumatismes.
Dans mon parcours précédent de travailleur social, j’ai longtemps accompagné en hébergements diffus. Dans ce cadre, la relation d’accompagnement était majoritairement formelle : rendez-vous au bureau, rendez-vous pour des visites à domicile. Dans cette nouvelle expérience en tant que cadre intermédiaire, j’ai pu mesurer l’importance des temps informels pour permettre une remobilisation. Je m’appuierai notamment sur les écrits d’Anthony Giddens pour saisir la base de la confiance, notion indispensable à tout travail d’accompagnement social.
Le service avait pour objectif d’offrir une solution aux nombreux jeunes âgés de 18 à 25ans, souvent sans revenus et exclus des systèmes d’hébergements classiques. Ayant connu la plupart du temps des parcours de placements dans l’enfance, selon les situations ils étaient entre une relation d’assistance caractérisé par l’assistanat (relation régulière et contractuelle) ou par la marginalité (relation infra-assistancielle), pour reprendre les classifications de Serge Paugam[1]. Le mis à disposition pour cette mission était un ancien Foyer d’Action Educative avec un espace restreint, le choix avait été fait de transformer une chambre en bureau d’accueil quasi permanent. Au fil du temps, ce bureau est devenu le lieu des plaintes, des « coups de gueules ». Le lieu où les jeunes venaient canaliser leurs émotions et chercher une écoute bienveillante et non jugeante. L’ont-ils toujours eu ?
Les conseils ne sont pas toujours bienvenus
J’ai observé des situations où le positionnement professionnel des travailleurs sociaux repose sur de nombreuses déformations (je m’inclus dans ce constat). L’une d’entre elles est de vouloir trop souvent donner des conseils, alors qu’ils n’ont pas été demandés. Sans partir d’une mauvaise intension, ces habitudes sont plus le reflet de la projection du travailleur social que la réelle volonté des bénéficiaires. Ces habitudes créent une frontière entre celui qui a le savoir et celui qui ne l’a pas, une relation au pouvoir déséquilibré. J’ai vu des collaborateurs être mis à l’épreuve par les jeunes. Ceux-ci ont trop connu ces injonctions au projet, ces activations du quotidien[2] aussi à l’origine de leur mise à distance des organismes d’insertion vers l’emploi. J’ai observé que la relation de confiance se tissait davantage avec les intervenants qui se gardaient de tout jugement sur les choix des jeunes dans les évènements qu’ils vivent. Ainsi, poursuivre ou arrêter une expérience professionnelle naissante pour certains jeunes devait être entendu comme une expérience de choix, sans jugement. Une crise de colère verbale contre un Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation devait être entendue et acceptée, au travailleur social de proposer un compromis pour canaliser le conflit sans juger le ressenti du jeune.
Il est plus facile de faire confiance à une personne qu’au représentant d’une institution
Le sociologue Anthony Giddens nous explicite le fondement de cette relation de confiance tissée. Il l’estime essentielle dans le contexte de la modernité pour faire face à des systèmes abstraits éloignés dans l’espace et dans le temps, telles les nombreuses institutions présentes dans nos quotidiens. Je tente d’appliquer sa théorie à mon expérience vécue pour comprendre la mise en place de la confiance dans un contexte d’insécurité ontologique. Pour lui en effet, la base de la confiance se construit dans la prime enfance en s’appuyant sur la sécurité ontologique. Or, la plupart des jeunes accueillis furent placés dans l’enfance et n’ont pas pu se fonder sur un cadre familial sécurisant pour bâtir leur relation à la confiance. Ce qu’ont vécu ces jeunes du fait de leurs fragilités entraine une méfiance importante, une insécurité ontologique. Giddens distingue la confiance-système et la confiance-personne. Je constate que la confiance due aux systèmes est quasiment absente, du fait de la distance vécue par les jeunes vis à vis des institutions et du ressenti essentiellement négatif qu’elles ont sur leur expérience de vie. D’autant plus lorsqu’ils comprennent que les institutions de la protection de l’enfance les ont laissé sans solution viable à l’entrée de l’âge adulte. Ainsi par exemple, je fais l’hypothèse qu’une persévérance des pratiques de fraude dans les transports en communs, alors qu’un tarif à très bas coût leur est proposé par la collectivité, vient en partie de cette distance avec le système abstrait que représente la Compagnie des Transports Strasbourgeois.
La confiance-personne quant à elle est possible, les travailleurs sociaux des accueils de jour ou de la prévention spécialisée ont installé cette relation avant qu’ils n’intègrent le dispositif. Pourquoi ne se transfère-t-elle pas simplement à d’autres professionnels ? Probablement parce que malgré leur volonté de vouloir bien faire, les travailleurs sociaux ne se placent plus toujours en tiers dans les évènements que vivent les jeunes, mais parfois de manière frontale. Ils cherchent à influencer le parcours du jeune en dispensant des conseils avec plus ou moins d’insistance dans le but de « réussir un travail d’insertion ». Ils entrainent une levée de la méfiance chez les personnes concernées qui conduit à un flétrissement, voire une rupture du lien. Evitements, demandes pour « changer de référent », demandes d’une aide à un intervenant social extérieur à l’organisation, passages à l’acte avec début d’agressivité sont autant de marques de cette distance qui s’installe.
Comment faire confiance aux autres si on doute de soi ?
Les intervenants doivent prendre en compte les nombreux traumatismes vécus dans l’enfance par la plupart des jeunes de ce dispositif. Ainsi, en s’appuyant sur les œuvres du psychologue Erik Eriksson, Giddens précise que« la confiance n’implique pas seulement que l’on a appris à compter sur l’identité et la continuité des pourvoyeurs extérieurs, mais également que l’on peut se faire personnellement confiance. La confiance envers les autres se développe conjointement à la formation d’un sentiment intérieur d’être digne de confiance, qui constitue la base d’une auto-identité ultérieure stable »[3] . La confiance-personne pour des jeunes qui se sont construits à partir d’une insécurité ontologique est constamment testée. La question de la légitimité accordée dans la relation se basera sur le positionnement du professionnel face à ce que vit le jeune. Si ce lien de confiance ne se construit pas, la relation d’accompagnement devient déséquilibrée et peut aller jusqu’à une volonté de prise de pouvoir du travailleur social au détriment de la personne concernée.
Pour poursuivre avec Giddens, dans sa théorie la sécurité ontologique nous permet d’être dans la réflexivité, attitude nécessaire dans le quotidien du monde moderne, surtout face aux risques. Concernant ces publics avec un vécu de précarité sociale, dans leur existence les discontinuités prennent plus de place que les continuités[4]. Le besoin de se préserver des multiples risques est donc important. C’est là que nous pouvons replacer le rôle des intervenants sociaux. Être des médiateurs dans la réflexivité que vivent ces jeunes face aux risques de leur parcours de vie, le tout en prenant compte de leur insécurité ontologique. « Est toujours présente dans la notion de confiance l’idée de pouvoir compter sur quelque chose face à certaines contingences, que ces dernières soient dues aux actions d’êtres humains ou au fonctionnement de systèmes[5] ». Dès lors, comment les institutions peuvent-elles permettre la meilleure expression de cette confiance pour adapter leur accompagnement ?
Redonner une place aux espaces l’informels pour venir « vider son sac »
Mes observations du quotidien ont montré que les entretiens dans un cadre formel, heure et lieu défini, ne suffisent pas à poser ce cadre bienveillant nécessaire à l’accompagnement d’un public fragilisé. Être présent dans les épreuves du quotidien demande une disponibilité dans le temps et dans l’espace. Le bureau d’accueil du dispositif, s’il a parfois manqué de cadre confidentiel, a par contre permis aux jeunes de « vider leur sac » lorsque le quotidien était trop lourd. Je note que pour la plupart d’entre eux, réorientés dans d’autres dispositifs ou accédant à un logement à la fin de l’expérimentation, ils en sont sortis dans de meilleures dispositions qu’en arrivant.
Les orientations actuelles des politiques sociales vers le logement d’abord vont dans le bon sens. Le statut d’hébergé temporaire limite la possibilité pour les publics accompagnés dans l’Accueil Hébergement Insertion de s’appuyer sur leur pouvoir d’agir et leur chez-soi pour construire leur parcours. Cependant, il ne faudrait pas que les services sociaux, agissant de plus en plus à domicile, technicisent à outrance l’intervention sociale. Les publics fragilisés ont besoin de lieux de décharges émotionnelles. Des lieux d’écoute bienveillante et non jugeante disponibles aisément et sans rendez-vous préalables, sans formalités. Ces lieux sont nécessaires pour accompagner la réflexivité des publics face aux nombreux risques qu’ils vivent dans leur exitance marquée de ruptures importantes et impactantes. Développer des accueils de jour de proximité, créer de la disponibilité, organiser la rencontre, permettront de mieux prévenir le risque de rechute. Le travailleur social sera aussi plus à même de retrouver une place ajustée, au côté des personnes et ce qu’elles vivent et non plus en face comme agents d’un contrôle social. Le métier n’en sera que plus valorisé.
Bibliographie :
[1]Serge Paugam, la disqualification sociale, PUF, 2009, 288p.
[2]Isabelle Astier, les nouvelles règles du social, PUF, 2007, 208p.
[3]Anthony Giddens, les conséquences de ma modernité, L’Harmattan, 2016, p100.
[4]Patrick Cingolani, la précarité, 2006, 128p.
[5]Anthony Giddens, Ibid p 40